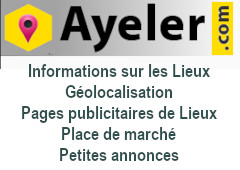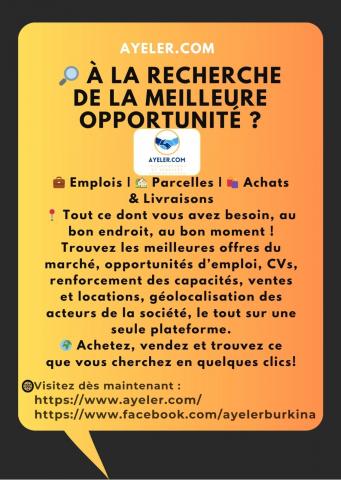Evaluation finale portant sur les pathologies maxillo-faciales et du noma au Burkina Faso et au Mali – H/F
Ouagadougou
02/05/2024 - 09:16

Annonceur
La Chaîne de l’Espoir
Professionnel
Appel d'offres
19 mai 2024
Bureaux d'études
Santé
Description de l'annonce
1. Présentation succincte de la structure commanditaire : La Chaîne de l’Espoir
La Chaîne de l’Espoir, association française fondée en 1994, est une ONG médicale internationale, indépendante, apolitique et non confessionnelle. Elle cible en priorité les personnes vulnérables, notamment les enfants et les femmes. Elle privilégie une logique d’intervention intégrée dans une chaîne de soins et une action commune avec les équipes locales, visant à leur autonomie. Pour ce faire, les médecins, soignants et techniciens bénévoles opèrent et forment aux techniques les plus adaptées aux besoins et contextes. La Chaîne de l’Espoir met en place les moyens structurels nécessaires à la chirurgie, tant matériels (construction hospitalière, équipement) qu’humains (compétences médico-chirurgicales paramédicales, techniques). En amont, nous investissons dans la prévention et le dépistage. La Chaîne de l’Espoir travaille en partenariat étroit avec tous les acteurs de la santé (autorités locales, hôpitaux, institutions internationales, associations, entreprises) pour apporter une réponse coordonnée et assurer un impact durable sur les conditions de vie des personnes vulnérables.
La mission de La Chaîne de l’Espoir est d’améliorer l’accès aux soins médico-chirurgicaux des personnes vulnérables, particulièrement les enfants et les femmes, dans des contextes de fragilité ou de crise en renforçant les systèmes de santé par la formation médico-chirurgicale, le soutien en ingénierie hospitalière et le transfert de nouvelles technologies.
Résolument tournée à l’international, La Chaîne De L’Espoir intervient aujourd’hui dans 27 pays. L’association dispose d’un vaste réseau de partenaires médicales et médicaux principalement en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. La Chaîne de l’Espoir déploie des missions dans le but de prendre en charge les enfants vulnérables, telles que :
- Les soins en France : lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les moyens de les soigner, les enfants sont accueillis en France pour être opérées dans des structures hospitalières partenaires.
- Les missions à l’étranger / La formation : lorsqu’il est possible d’opérer les enfants chez eux, La Chaîne de l’Espoir assure la formation du personnel médical local dans les domaines de spécialités répondant aux différentes pathologies par le biais des missions opératoires, techniques et de formations pratiques et théoriques. Dans le cas où la méconnaissance des pathologies (telles que le noma et sténoses caustiques de l’oesophage) entraîne un risque accru pour les victimes, les projets intègrent également un volet prévention et sensibilisation de la population et du personnel médical.
- Les projets hospitaliers : La Chaîne de l’Espoir réhabilite, construit et équipe des structures hospitalières adaptées. L’association apporte un soutien technique à la création ou réhabilitation de structures hospitalières dédiées aux soins pédiatriques, comme au Cambodge, en Afghanistan, au Mozambique, au Sénégal, au Mali et en Irak.
- Les programmes de santé scolaire et éducation à la santé : La Chaîne de l’Espoir favorise l’accès à l’éducation d’enfants défavorisés et développe des programmes de santé scolaire, dépistage, prévention et éducation à la santé dans les écoles.
Chaque année, ce sont près de 10 000 patients qui sont pris en charge par La Chaîne de l’Espoir grâce à environ 70 missions médicales et 56 missions de coordination, exploratoires ou techniques. En outre, 400m3 et 40 tonnes d’équipements et de consommables sont également expédiés tous les ans dans les différents pays d’intervention. Cela est rendu possible grâce aux plus de 800 collaborateurs de La Chaîne de l’Espoir dans le monde (incluant salariés et bénévoles).
2. Descriptif du projet à évaluer
A. Informations générales, contexte national et local
1) Contexte du Burkina Faso
Le Burkina Faso connait depuis 2019 une crise multidimensionnelle qui continue de s’intensifier.
Depuis que le pays est passé sous régime militaire à la suite de deux coups d’Etat (24 janvier 2022 puis 30 septembre 2022), la situation politique, sécuritaire et économique est critique et se caractérise par la violence accrue et l’extrême pauvreté.
Au niveau politique, le gouvernement de transition du Burkina Faso est désormais lié à ceux du Mali et du Niger par l’Alliance des États du Sahel (AES), une coopération de défense établie en septembre 2023 entre le nigérien Abdourahmane Tiani, le malien Assimi Goïta et enfin le burkinabè Ibrahim Traoré. Cette solidarité diplomatique permet d’offrir un front commun face à la menace sécuritaire djihadiste mais également face aux pressions étrangères, tout en s’émancipant de la CEDEAO (les 3 pays ont annoncé leur retrait de cette organisation le 28/01/2024).
Concernant l’aspect sécuritaire, le Burkina Faso est dans une situation des plus complexes. Les groupes djihadistes contrôlent environ 40% du territoire, principalement dans la partie nord et dans l’est du pays. Des attaques sont perpétrées de manière récurrente dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel. Depuis 2015, les violences djihadistes ont fait près de 17 000 victimes au Burkina Faso et ont provoqué le déplacement interne de plus de deux millions de burkinabè, soit 1 burkinabè sur 10.
En 2023, le nombre de personnes nécessitant un appui humanitaire était estimé à 4,7 millions, soit 20% de la population du pays selon l’Humanitarian Response Plan (HRP). La situation sécuritaire met à rude épreuve le fonctionnement du système de santé et a engendré un dysfonctionnement dans l’offre de soins.
2) Contexte du Mali
La première phase de ce projet, qui s’est déroulée entre janvier 2018 et juin 2021, a été exécutée uniquement au Burkina Faso. La deuxième phase a inclus le Mali.
Depuis 2012, le Mali vit une situation de crise sécuritaire et humanitaire qui a engendré de nombreux incidents sécuritaires et des mouvements de populations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
Depuis juillet 2021, la situation au Mali a connu des évolutions complexes. Sur le plan sécuritaire, les défis persistants liés aux groupes armés et aux attaques terroristes ont exacerbé la vulnérabilité des populations. Politiquement, les transitions de pouvoir et les tensions internes ont accentué l’instabilité, impactant les efforts de stabilisation et de gouvernance. Humanitairement, la demande d’assistance a crû, soulignant les besoins accrus des populations affectées. Socialement et économiquement, les conséquences des crises sécuritaires et politiques ont renforcé les difficultés, notamment en matière d’accès aux services essentiels et d’opportunités économiques, aggravant la précarité de la situation.
Au Mali, le 24 mai 2021, un coup d’État a mis à la tête du gouvernement de transition le Vice-président Assimi Goïta. À cela s’ajoute la crise diplomatique entre la France et le Mali ayant conduit à la suspension de l’aide publique française et à l’arrêt des activités des organisations ayant bénéficié des financements de la France dès fin novembre. Cette crise diplomatique a aussi provoqué le départ de l’Ambassadeur de France et de la force militaire Barkhane du Mali. Globalement, les relations entre les Nations Unies et les ONG françaises d’une part, et les gouvernements des deux pays d’intervention, d’autre part, se sont complexifiées.
Concernant la situation humanitaire au Mali, selon l’HRP 2023, le nombre de personnes dans le besoin est passé de 7,5 millions en janvier 2022 à 8,8 millions en janvier 2023. Cela correspond à une hausse de 17% entre 2022 et 2023, illustrant l’aggravation des besoins humanitaires. L’insécurité grandissante a entraîné un dysfonctionnement du système sanitaire déjà fragile dans les deux pays, limitant l’accès aux soins de santé primaires à la suite de la fermeture des formations sanitaires et à la réduction des services. Selon le Cluster Santé, 195 formations sanitaires n’étaient pas fonctionnelles. 82 étaient partiellement fonctionnelles sur un total de 2 664 formations sanitaires. Les activités prévues en fin d’année 2022 au Mali n’ont pas pu être mises en oeuvre (1 mission de chirurgie et des formations des agents de santé) suite à la cessation des activités.
La Chaîne de l’Espoir et ses partenaires ont dû s’adapter en procédant à des ajustements opérationnels et en mettant en place de nouvelles mesures de sécurité pour pallier la dégradation du contexte.
B. Focus sur les pathologies maxillo-faciales
Le Burkina Faso et le Mali font partie des pays les plus touchés par les pathologies maxillo-faciales. L’accès aux soins nécessaires pour traiter ces pathologies est difficile du fait du manque d’offre locale de soins, de contraintes financières et de l’instabilité du point de vue sécuritaire.
Les pathologies maxillo-faciales sont très variées et affectent la zone du visage comprenant la mâchoire, les dents, les os du crâne, les muscles et les tissus mous. Elles vont des fractures souvent causées par des accidents, aux infections dentaires, aux tumeurs, aux malformations congénitales telles que les fentes labio-palatines ainsi qu’au noma.
Selon l’étude sur la charge mondiale de morbidité en 2019, les affections bucco-dentaires touchent plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde. Il s’agit des caries dentaires, des maladies parodontales (gencives) entraînant la perte de dents, les cancers des lèvres et de la cavité buccale, le noma, les fentes labio-palatines, les lésions dentaires d’origine traumatique.
Bien que le Burkina Faso se soit doté depuis 2002 d’un programme national de santé bucco-dentaire et de lutte contre le noma (PNSBD/LN), des actions de prévention et de sensibilisation d’envergure manquent.
Le Mali, ne possède pas un programme national de santé bucco-dentaire et de lutte contre le noma. En 2021 et en 2022, 101 904 et 106 961 actes d’odontostomatologie ont été réalisés respectivement dans les hôpitaux de deuxième et de troisième référence. Seulement 8 cas de plastie de séquelles de Noma ont été pris en charge au niveau des hôpitaux de deuxième référence en 2021 et 10 cas en 2022. Au niveau de premier échelon, le système d’information notifie les cas de Noma, de carie dentaire, gingivite simple et gingivite ulcéro-nécrotique aiguë.
Ces pathologies sont encore mal connues à la fois des populations et du personnel médical et paramédical, surtout en région. Ainsi, la difficulté d’accès aux soins et l’ignorance face aux premiers signes entraînent une prise en charge tardive, voire une absence totale de traitement.
C. Présentation du projet à évaluer
Nom du projet : Prévention et prise en charge intégrée des pathologies maxillo-faciales et du noma au Burkina Faso et au Mali Lieux d’intervention : Burkina Faso > régions du Plateau central, du Centre-Est, du Centre-Ouest, de l’Est, des Cascades et du Centre Mali > régions de Mopti, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et district de Bamako Thématique(s) principale(s) : Promotion de la santé, prévention, formation, renforcement de capacités, prise en charge médico-chirurgicale, support psychosocial, handicap, chirurgie maxillo-faciale
À la suite d’une première phase pilote du 01/01/2018 au 30/06/2021, la seconde phase du projet, co-financée par l’Agence Française de Développement, La Chaîne de l’Espoir et la Fondation Sentinelles, a démarré le 01/07/2021 et se terminera le 31/12/2024.
Cette phase consiste en la mise à l’échelle d’une approche intégrée pour lutter contre les pathologies et malformations maxillo-faciales, y compris le noma, au Burkina Faso et au Mali. Il s’agit de renforcer la société civile et d’intervenir à tous les niveaux de la pyramide sanitaire à travers un paquet d’activités allant de la sensibilisation des populations aux causes et aux moyens de prévenir certaines pathologies faciales, à la prise en charge médico-chirurgicale, en passant par le renforcement des compétences des professionnels de la santé et la réinsertion sociale des personnes suivies. Ce projet s’adresse principalement aux populations (les communautés hôtes, les personnes déplacées internes et les personnes réfugiées) ainsi qu’aux personnels de santé, aux relais communautaires et aux tradipraticien.ne.s des régions ciblées. A noter que les activités du Mali ont été arrêtées en novembre 2022 à la suite de l’annonce de la suspension des financements publics français au Mali.
OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET
- OBJECTIF GLOBAL : Contribuer à améliorer la santé et le bien-être de la population du Burkina Faso et du Mali en matière de pathologies maxillo-faciales, y compris du noma
- OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Améliorer la détection et le référencement des pathologies maxillo-faciales, y compris du noma, par les personnels de santé, les tradipraticiens et la société civile
Résultat 1.1 : Les personnels de santé, les tradipraticien.ne.s et les ASBC savent détecter des cas de malformation maxillo-faciale et de noma, et connaissent les possibilités de référencement des patients et les mesures préventives des conditions favorisant l’apparition du noma. Principales activités prévues : Formation et sensibilisation des personnels de santé, des tradipraticien.ne.s, des ASBC et des ICP au Burkina Faso et des agent.e.s de santé et tradipraticiens au Mali. Résultat 1.2 : Les connaissances de la société civile (relais et radios communautaires) sur les pathologies et malformations faciales sont renforcées. Principales activités prévues : Formation des relais communautaires à la sensibilisation sur le noma et les pathologies maxillo-faciales et transfert de compétences et échange d’expériences avec les radios partenaires.
- OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Promouvoir la prévention des pathologies maxillo-faciales, y compris du noma, et l’inclusion sociale des personnes atteintes
Résultat 2.1 : Les autorités administratives, coutumières, religieuses et associatives sont sensibilisées et s’engagent à appuyer le projet. Principales activités prévues : Rencontres d’information et sensibilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses, enregistrement et diffusion de messages de sensibilisation radio. Résultat 2.2 : Les populations des villages cibles ont une meilleure compréhension des problématiques liées à ces pathologies. Principales activités prévues : Tenue de causeries par les relais communautaires, représentations de théâtre forum, formation d’enseignants et d’élèves membres de clubs scolaires.
- OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Rendre accessible les soins médico-chirurgicaux pour les patient.e.s atteints de pathologies maxillo-faciales, y compris du noma, et favoriser leur inclusion socio-économique
Résultat 3.1 : Les patients référés atteints de pathologies ou malformations faciales bénéficient d’une PEC médico-chirurgicale. Principales activités prévues : Recrutement, référencement et sélection des patients en vue des missions opératoires, voir en consultation et opérer les patients en compagnonnage. 8 Résultat 3.2 : Les équipes médicales locales améliorent leurs connaissances sur les techniques spécifiques de chirurgie reconstructrice des malformations et pathologies faciales. Principales activités prévues : Renforcer les compétences du personnel de santé burkinabè et malien par compagnonnage lors des opérations chirurgicales, dispensation de cours théoriques. Résultat 3.3 : L’inclusion socio-économique des enfants atteints de noma et de leur famille est favorisée par un soutien psychosocial et économique. Principales activités prévues : Octroyer une aide économique aux familles pour soutenir des AGR, sensibiliser à la nécessité de la scolarité et inscrire l’enfant dans un établissement scolaire, soutenir la formation professionnelle des adolescents et jeunes adultes.
PRINCIPAUX PARTENAIRES
Les Ministères de la Santé du Burkina Faso et du Mali : Ils ont approuvé le projet et suivent sa mise en oeuvre à travers le COPIL. Ils peuvent également appuyer la mise en oeuvre de certaines activités grâce à leurs DRS dans les zones d’intervention du projet.
Les OSC :
- La Voix du Paysan est une radio communautaire burkinabé qui intervient dans le volet formation de la société civile et sensibilisation grand public avec des radios communautaires partenaires dans les zones ciblées
- Sentinelles est une organisation suisse active au Burkina Faso dans la lutte contre le noma depuis plus de 20 ans. Elle co-finance le projet et est impliquée dans la formation des personnels de santé dans les CSPS et dans la PEC médico-chirurgicale notamment pré et post-opératoire dans son centre d’accueil
- Bilaadga est organisation burkinabé, intervient dans le recrutement et l’accueil des patients
- L’association NF au Mali s’est donnée pour objectif de changer le regard fataliste des populations vis-à-vis des malades du noma par l’information et la sensibilisation, la formation, la PEC globale des malades et l’accompagnement et la réinsertion des personnes guéries
Les centres hospitaliers :
- CHME « Le Luxembourg » : hôpital privé de 3ème niveau créé en 1998 à Bamako. En 2018, une convention signée avec La Chaîne de l’Espoir a permis l’ouverture d’une extension, le Centre André FESTOC, unité de chirurgie pédiatrique consacrée à la chirurgie cardiaque.
- Le CHU de Bogodogo et l’Hôpital Saint Camille à Ouagadougou : deux structures hospitalières qui ont accueillies des missions chirurgicales dans le cadre du projet.
- LE CHU de Yalgado à Ouagadougou : est un lieu d’internat de nombreux médecins en spécialisation de chirurgie maxillo-faciale au Burkina Faso. Il supervise la participation de ces médecins en spécialisation aux missions de compagnonnage organisée par La Chaîne de l’Espoir. Il assure la prise en charge chirurgicale des patients opérés entre les missions dans le cadre de l’activité pilote proposée en tranche 2 de cette seconde phase du projet.
- Hôpital Saint Camille : l’Hôpital accueille les missions chirurgicales mises en oeuvre dans le cadre de ce projet.
BENEFICIAIRES DU PROJET PAR VOLET
Les bénéficiaires directs du projet :
- Renforcement de la société civile et formation des agents de santé : 1 560 personnels de santé, 780 ASBC des CSPS des régions ciblées au Burkina Faso, 1 126 tradipraticiens, 600 relais communautaires issus des AME, APE, CVD, ASBC, club de fidèles auditeurs.
- Sensibilisation et prévention : 1 200 autorités administratives et communautaires, 25 personnes formées dans 5 radios partenaires, 120 élèves des clubs scolaires, 40 enseignants et directeurs d’écoles, 3 000 foyers touchés par les causeries porte-à-porte, 30 000 ressortissants des villages cibles.
- PEC médico-chirurgicale et sociale : 850 patients consultés, 600 patients PEC, 63 personnels médicaux, paramédicaux et chirurgicaux spécialisés, 18 enfants et jeunes adultes accompagnés pour la réinsertion professionnelle.
Les bénéficiaires indirects : 850 familles de patients, 20 établissements scolaires, 20 459 641 habitants des régions cibles.
BUDGET DE LA PHASE 2 DU PROJET
- Budget total du projet : 1 700 000 €
- Tranche 1 (18 mois) : 972 345 €
- Tranche 2 (18 mois + extension de 6 mois) : 727 655 €
- Les principales dépenses couvrent : les ressources humaines (31,5%), les activités non ventilables (31,2%), l’immobilier, les équipements techniques et mobiliers (4,6%), les frais de services, les achats et les locations (9,6%), les frais d’études, de consultances et de prestations externes (dont audit et évaluation) (3,2%), les frais de voyages, de déplacements et de mission (7,5%).
- Contribution de l’AFD : 700 000 € (41,2%).
- Contribution de La Chaîne de l’Espoir : 759 270 € (44,7%)
- Valorisation d’origine privée : 130 000 (7,6%)
- Contribution de Sentinelles : 110 730 € (6,5%)
3. L’évaluation finale du projet
A. Justification de l’évaluation
L’évaluation envisagée est réalisée dans le cadre du projet de « Prévention et prise en charge intégrée des pathologies maxillo-faciales et du noma au Burkina Faso et au Mali » mis en oeuvre par La Chaîne de l’Espoir et ses partenaires depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2024. Une évaluation externe est indispensable à La Chaîne de l’Espoir et ses partenaires pour rendre compte à l’AFD qui cofinance le programme. Au-delà de cette obligation contractuelle vis-à-vis de l’AFD, l’évaluation envisagée est nécessaire pour orienter la conception et la mise en oeuvre de futures interventions de La Chaîne de l’Espoir sur la thématique concernée. L’évaluation permettra donc de mettre en exergue les apprentissages qui peuvent être tirés de l’expérience de la seconde phase du programme afin d’améliorer la mise en oeuvre des actions dans les nouvelles zones ciblées. Il est en effet envisagé, à la suite de cette phase du projet, une extension à d’autres pays en cours d’identification. D’autre part, le choix d’une évaluation externe vise à assurer l’indépendance, l’impartialité et la crédibilité du processus et des résultats. Ce choix est aussi guidé par le souhait de recueillir de nouvelles idées et recommandations.
B. Objectif de l’évaluation
Le consultant devra établir un bilan global et objectif des actions de la seconde phase de ce projet visant à évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints, identifier les leçons apprises et à formuler des recommandations pour l’amélioration des interventions futures dans ce domaine dans les pays concernés et au-delà.
QUESTIONNEMENTS ENCADRANT L’ÉVALUATION
Résultats des actions (non exhaustif)
- Les résultats visés par le programme ont-ils été atteints (en matière de sensibilisation, renforcement de compétences, référencement, prise en charge médico-chirurgicale) ? Comment les apprécier quantitativement et qualitativement ? Certains résultats atteints pourraient-ils avoir des effets à moyen ou long terme ? sous quelles conditions ? Les activités de sensibilisation communautaire (formation de relais communautaires, causeries porte à porte, plaidoyers auprès des leaders dans les villages et au niveau des communes, théâtre forum, micro-programmes radiophoniques, interventions dans les écoles) ont-elles permis d’améliorer les connaissances des populations sur le noma et les pathologies maxillo-faciales ? Ont-elles permis de changer le regard sur les personnes portant ces maladies ? Y a-t-il de nouveaux acteurs à cibler ou de nouvelles méthodes à intégrer ?
- Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des radios partenaires du programme a-t-il effectivement permis d’améliorer la communication sur le noma et les pathologies maxillo-faciales dans les régions concernées ?
- Le dispositif mis en place pour la formation des personnels de santé dans les centres de santé à base communautaire et des tradipraticiens est-il suffisant ?
- La méthode de transfert des compétences par compagnonnage à l’occasion des missions chirurgicales est-elle efficace ?
- Quelle appréciation est faite par les chirurgiens locaux des techniques apprises lors des missions de compagnonnage ?
- Quels facteurs ont permis d’atteindre les résultats observés ? Quels ont été les freins ?
- Comment améliorer le suivi des actions ? Les outils et les méthodes de suivi actuels peuvent-ils être améliorés ?
- Les actions mises en place pour renforcer le suivi des personnes prises en charge au-delà des aspects médico-chirurgicaux sont-elles satisfaisantes et suffisantes ?
- Dans quelle mesure l’arrêt des activités au Mali a impacté les principaux bénéficiaires et les partenaires locaux ?
Stratégie d’intervention (non exhaustif)
- L’approche intégrée a-t-elle été pertinente au regard des enjeux du programme et des besoins locaux ?
- Cette approche a-t-elle permis de répondre efficacement et de manière efficiente aux besoins préalablement identifiés ? A-t-elle permis de couvrir les attentes des populations cibles, notamment les personnes victimes de noma ?
- La mise à l’échelle du modèle d’intervention au Mali a-t-elle été satisfaisante ? Quelles ont été les réussites et les freins ?
- Quelles seraient les points d’attention à prendre en compte pour favoriser la mise à l’échelle de l’approche intégrée dans d’autres pays ?
Dispositifs de mise en œuvre et partenariats (non exhaustif)
- L’organisation interne du projet, sa gouvernance et la complémentarité des organisations partenaires ont-elles permis de mettre en œuvre les actions de manière adéquates ?
- Quelle a été la qualité de la collaboration entre l’équipe de mise en oeuvre et les autorités publiques concernées (ministère de la Santé, autorités administratives locales, centres de santé, etc.), ainsi qu’avec les autres acteurs associatifs (ONG internationales, associations nationales) ?
- Comment le projet et l’équipe ont-ils été perçus par les différents acteur.ice.s (étatiques, associatif.ve.s et internationaux.ales) ?
- Comment l’équipe de mise en oeuvre a-t-elle fait face et s’est adaptée à l’évolution du contexte (insécurité, arrêt des activités au Mali) ?
- Les capacités de mise en œuvre et de gestion des partenaires ont-elles été évaluées ? Le cas échéant, les actions de renforcement des capacités mises en place par La Chaîne de l’Espoir ont-elles été suffisantes au regard des enjeux en la matière ? Ces actions ont-elles permis un renforcement opérationnel des partenaires ? Un renforcement institutionnel de ces partenaires ? Comment qualifier la relation partenariale de La Chaîne de l’Espoir avec chaque partenaire au terme du projet : qualité, profondeur, évolution sur la durée du projet ?
- Quelle a été l’implication des familles et des enfants à la mise en place des actions qui leur ont été destinées, sensibilisation et prise en charge médico-chirurgicale notamment ?
- De quelle manière La Chaîne de l’Espoir et ses partenaires pourraient-ils renforcer l’articulation avec d’autres acteur.trice.s ? Sur quels axes de travail ?
- Comment renforcer l’implication des familles et des enfants / des communautés dans la mise en place des activités afin de favoriser des apprentissages de pair à pair et une meilleure appropriation ?
Questionnements transversaux
- En quoi le projet, dans sa partie sensibilisation, a-t-il renforcé ou transformé les normes de genre dans les zones d’intervention ? Quels effets ont été induits, particulièrement quant au rôle des femmes et des hommes dans la communauté ?
- Le projet a-t-il eu un impact différencié entre filles et garçons pris.es en charge ? Au niveau du staff médical, et des personnels des organisations partenaires ?
- Comment la mise de l’échelle du projet a-t-elle intégré la prise en compte du genre ?
- Comment intégrer la prise en compte du genre dans la réplication du projet dans des contextes différents (Océan Indien et Afrique de l’Ouest) ?
- De quelle manière cette réplication pourrait-elle intégrer une approche par les droits des enfants ?
Il est demandé aux consultant.es, dans leur offre de services, de reformuler et d’organiser le questionnement évaluatif qu’ils proposent de traiter autour de ces axes de réflexion et de questionnements, en fonction de leur compréhension de la problématique, des enjeux et des objectifs de l’évaluation qu’ils auront exposés par ailleurs.
C. Méthodologie proposée
En termes de méthodologie, il est attendu une évaluation de type participatif favorisant l’implication des principales parties prenantes, notamment les partenaires de mise en oeuvre qui forment le comité de pilotage du projet et les familles et patient.e.s qui sont les destinataires finaux des actions mises en place. Le.la consultant.e devra également veiller à respecter les exigences d’évaluation de l’Agence Française de Développement.
Analyse Documentaire
- Examiner les rapports narratifs et financiers du projet.
- Étudier les documents stratégiques pertinents, y compris les comptes rendus des comités de pilotage, le rapport de l’évaluation finale de la première phase de ce projet, etc.
La Chaîne de l’Espoir mettra à la disposition du/de la consultant.e toute la documentation nécessaire.
Évaluation participative sur le Terrain
- Effectuer des visites sur le terrain dans les zones d’intervention du projet au Burkina Faso et au Mali.
- Conduire des entretiens semi-structurés avec les parties prenantes clés (les bénéficiaires, le personnel de santé, les autorités locales, les relais communautaires, les radios locales bénéficiaires, les partenaires du projet, etc.).
- Organiser des réunions participatives avec les communautés bénéficiaires pour recueillir leurs perspectives sur l’efficacité du projet et les défis rencontrés.
Dans les chefs-lieux et villages des régions ciblées par le projet, le choix des villes et villages à visiter sera arrêté avant le début de la mission de terrain, en fonction notamment de l’évolution de la situation sécuritaire. Toutefois, afin de limiter les déplacements, un échantillonnage des lieux à visiter est possible et pourrait être réalisé, le cas échéant, avec les organisations partenaires. Pour les déplacements en région, les consultants pourront être accompagnés par les équipes projet qui resteront disponibles sur toute la durée de la mission pour faciliter le travail. Ces déplacements pourraient se faire avec les véhicules du projet si cela est souhaité et possible. Pour les consultants non nationaux, le cas échéant, La Chaîne de l’Espoir ne sera pas responsable de leur déplacement ni de leur sécurité mais se tient à leur disposition pour tout appui nécessaire.
Analyse des Données
- Analyser les données quantitatives et qualitatives collectées pendant la durée du projet.
- Évaluer la couverture, la qualité et l’impact des services fournis aux populations cibles.
Le consultant complétera et ajustera cette proposition méthodologique dans son offre technique.
D. Livrables Attendus
- Rapport provisoire
- Rapport final de l’évaluation comprenant :
- – Analyse des réalisations par rapport aux objectifs fixés.
- – Identification des bonnes pratiques et des défis rencontrés.
- – Recommandations pour renforcer les interventions futures dans le domaine de la prévention et de la prise en charge des pathologies maxillo-faciales et du noma au Burkina Faso, au Mali et dans d’autres pays d’intervention de La Chaîne de l’Espoir.
- – Un résumé de l’évaluation (maximum 5 pages)
- Présentation synthétique des résultats de l’évaluation sur PowerPoint qui servira de support lors de la réunion de restitution finale.
E. Équipe d’Évaluation
L’équipe de l’évaluation sera composée de professionnels expérimentés dans le domaine de la santé publique, de la médecine communautaire et de l’évaluation de projets humanitaires. L’équipe d’évaluation sera composée d’au moins deux consultants ayant, si possible, déjà travaillé ensemble dans le cadre d’évaluation de programme de développement dont au moins une personne de nationalité burkinabè résidant au Burkina Faso ou de nationalité malienne résidant au Mali. L’un des deux consultants sera chef de mission. En cas de binôme avec une personne résidant au Mali, cette dernière ne pourra être cheffe de mission en raison des dispositions prises par l’AFD concernant ce pays.
Les compétences attendues de l’équipe et qui seront valorisées lors de la sélection sont :
- Expérience valorisée dans l’évaluation de projet de développement dans le secteur de la santé notamment le renforcement de systèmes chirurgicaux, des approches en santé communautaire, ainsi que des stratégies de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées.
- Maitrise des outils et techniques d’enquêtes et d’entretiens.
- Expérience valorisée dans les méthodologies d’évaluation participative et d’organisation d’ateliers.
- Idéalement, bonne connaissance du Burkina Faso, du Mali ou à minima de la zone sahélienne.
- La capacité d’échanger dans les langues locales (notamment Dioula, Mooré, Bambara, Peulh,) serait appréciée.
- Une sensibilité aux enjeux de genre, particulièrement en santé communautaire, sera valorisée.
La composition détaillée de l’équipe sera à présenter dans l’offre technique.
F. Calendrier prévisionnel de l’valuation finale de ce projet
- Date limite de réception des dossiers de candidatures > 19 mai 2024 (Responsable : Comité de sélection de La Chaîne de l’Espoir)
- Recrutement du consultant > 31 mai 2024 (Responsable : Comité de sélection de La Chaîne de l’Espoir)
- Rencontre de cadrage des TDR et de la méthodologie proposée par le consultant > 14 juin 2024 (Responsables : Comité interne de La Chaîne de l’Espoir et Consultant)
- Préparation de la mission d’évaluation sur le terrain > Juillet 2024 (Responsables : Consultant et La Chaîne de l’Espoir)
- Mise en oeuvre de l’étude au Mali et au Burkina Faso > Août 2024 (Responsable : Consultant)
- Soumission du rapport provisoire de l’évaluation finale > 15 Septembre 2024 (Responsable : Consultant)
- Ajustements et validation du rapport provisoire > du 16 au 31 septembre 2024 (Responsables : Comité interne de La Chaîne de l’Espoir pour l’étude et consultant)
- Soumission du rapport final de l’étude (et de son résumé de maximum 5 pages) > 15 octobre 2024 (Responsable : Consultant)
- Soumission de la présentation Powerpoint présentant les résultats de l’étude > 15 octobre 2024 (Responsable : Consultant)
- Participation online à la restitution auprès des parties prenantes > Novembre 2024 (Responsables : Consultant et La Chaîne de l’Espoir)
Une communication régulière entre les consultants et La Chaîne de l’Espoir devra être réalisée tout au long du processus d’évaluation. Les partenaires du projet sont consultés à chaque étape de l’évaluation par les responsables de projet de La Chaîne de l’Espoir. Les conclusions de cette évaluation seront communiquées à l’AFD par La Chaîne de l’Espoir.
G. Budget alloué à l’évaluation finale du projet
Budget avec coûts détaillés
Le plafond du budget de l’évaluation est fixé à 25 000 euros TTC. Ce budget comprend notamment les honoraires, les perdiem (en France, au Burkina Faso et au Mali, y compris jours de voyage internationaux), les frais de visa et de santé, de communication, et les déplacements (internationaux, sur le terrain et en France). Les déplacements terrain en dehors de Ouagadougou et de Bamako pourront être effectués avec des véhicules du projet sur demande de l’équipe évaluatrice et si ces véhicules sont disponibles. Dans ce cas, le budget de l’évaluation devra inclure des frais de participation pour le carburant. Cependant, la situation sécuritaire limitera les possibilités de déplacement. Des imprévus peuvent être intégrés dans ce budget (5% maximum des coûts directs, sur justificatifs, seront éventuellement utilisables avec l’accord de La Chaîne de l’Espoir).
Il est demandé aux consultants de faire dans leur offre une proposition budgétaire détaillée TTC en tenant compte de ces éléments.
4. Dossier de candidature
A. Dossier administratif
Le dossier de candidature doit comporter :
- Un curriculum vitae décrivant les expériences professionnelles des consultants
- 3 références professionnelles du consultant principal
- Rapport d’au moins 1 évaluation réalisée
- L’adresse physique du cabinet ou du consultant indépendant
- Les numéros de contact téléphonique du cabinet et des consultants impliqués dans cette consultation
- Le nom complet et les coordonnées de la personne-ressource à contacter
- Attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle
- Déclaration d’intégrité remplie (document joint)
Pour les entreprises de droit français, les documents légaux ci-dessous devront être fournis :
- Extrait K-bis de moins 3 mois
- Attestation de déclaration à l’URSSAF
- Bilan annuel 2023 de formations et financier le cas échéant
Pour les entreprises étrangères, d’autres documents légaux pourront être demandés en fonction du lieu d’exercice.
B. Offre technique
L’offre technique doit être composée de :
- La présentation de l’expertise et de l’expérience du soumissionnaire
- Une note explicative sur la compréhension des TDR
- Une description de la méthodologie permettant d’atteindre les objectifs et de l’organisation de la mission envisagée
- Une proposition d’un chronogramme prévisionnel mentionnant les différentes phases et respectant les délais présentés dans les TDR
C. Offre financière
Le dossier de candidature comportera une offre financière détaillée, étant précisé que l’ensemble des coûts, mis à part la restitution finale qui sera organisée par La Chaîne de l’Espoir, sera à la charge du consultant.
Afin de faciliter la comparaison des offres financières, il est recommandé aux soumissionnaires de fournir une ventilation du montant proposé. Les soumissionnaires doivent spécifier dans cette ventilation budgétaire les honoraires et tous les coûts associés, en tenant compte du nombre de jours de travail prévus, des activités programmées, du matériel à produire, ainsi que du nombre de jours sur le terrain, conformément à ce qui aura été décrit dans la proposition technique. Les modalités et conditions financières doivent être également précisées.
Par ailleurs, les soumissionnaires voudront bien noter que les paiements ne pourront être effectués que sur la base des produits livrés, c’est-à-dire sur présentation du résultat des services spécifiés dans les TDR et après validation de ces livrables par les services compétents au sein de La Chaîne de l’Espoir.
L’offre ne devra pas excéder 25 000 (vingt-cinq mille) euros TTC.
NB : Bien vouloir noter que les offres doivent être soumises en TTC pour les soumissionnaires qui sont au régime normal. Selon la législation applicable, La Chaîne de l’Espoir effectuera une retenue à la source des éventuelles taxes. L’offre financière doit être disponible dans un fichier Excel détaillé.
En tenant compte de tous les éléments ci-dessus, il est demandé aux consultants de faire, dans leur offre de service, des propositions détaillées en ce qui concerne la méthodologie qu’ils se proposent de mettre en oeuvre (étapes de l’évaluation, acteurs consultés, réunions et restitutions, méthodologie de collecte d’information, documents produits, articulation avec La Chaîne de l’Espoir). Les consultants proposeront également, dans leur offre de services, la répartition du nombre de jours de travail aux différentes phases de l’évaluation, entre chaque consultant. Ils indiqueront les expériences de collaboration préalables des consultants de l’équipe, comment ils se coordonneront pour l’évaluation, et mettront en avant leur complémentarité au regard du travail demandé.
5. Critères d’évaluation des offres
(Voir « Termes de références » sur le lien en bas de page)
6. Comment postuler
Les offres technique et financière et le dossier administratif doivent être envoyés par email à l’adresse suivante : cnicolas@chainedelespoir.org
Date finale de réception des dossiers de soumission : 19 mai 2024.
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés d’ici le 1er juin 2024.
- Termes de références :https://www.chainedelespoir.org/sites/default/files/tdr_evaluation_finale_projet_maxillo_cde_v2.pdf
- Annexe – Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social :https://www.chainedelespoir.org/sites/default/files/annexe_declaration_dintegrite_2024.pdf